Un aperçu des travaux des chercheurs polonais spécialisés en bande dessinée
Un aperçu des travaux des chercheurs polonais spécialisés en bande dessinée
Michał Traczyk
En Pologne, avant la Seconde Guerre mondiale, les histoires en images avec du texte placé sous la case jouissaient d’une grande popularité auprès des lecteurs. Elles paraissaient surtout dans la presse, en améliorant les ventes, raison pour laquelle ces publications étaient assez nombreuses. Comme l’objectif premier de la bande dessinée polonaise consistait alors à divertir, leurs auteurs ne prenaient pas toujours ce volet de leur activité au sérieux. Les critiques, dans la mesure où il la remarquaient, ne faisaient pas grand cas de sa valeur artistique et culturelle. Ils préféraient se focaliser sur la présence importante des comic strips dans la presse anglophone.
L’intérêt pour la bande dessinée augmenta après le conflit, mais plutôt que pour ses qualités artistiques, à cause du nouveau contexte de guerre froide et de ses enjeux politiques et idéologiques. La presse polonaise y voyait une source de l’effondrement moral des Américains et du fort taux de délinquance juvénile chez eux. Selon ses journalistes, ces récits en images étaient tous, sans exception, vulgaires et puérils, facteurs d’analphabétisme et de racisme, influençant les jeunes esprits et les subjuguant tel un narcotique.
Cette ligne directrice de la critique de la période d'après-guerre s’ancra pour longtemps dans la conscience collective. L’image d'une bande dessinée vue comme un support vide véhiculant des contenus superficiels et dangereux ne pouvait être inversée par les rares analyses de fond, au degré d’exactitude variable, s’écartant du principe dominant. Citons pourtant celle d’Aleksander Hertz publiée dans Kuźnica en 1947 – dans laquelle le sociologue a reconnu dans les bandes dessinées une variété de contes se référant aux mythes et aux valeurs qui sont importants pour la société américaine. Une petite histoire de la bande dessinée (Mała historia komiksów, 1964) d’Andrzej Banach contient non seulement une comparaison extrêmement périlleuse entre différents genres de la bande dessinée et ceux de la littérature (épique, dramatique et lyrique), mais fait également remonter ses débuts à l’Égypte ancienne. Les articles de Janusz Dunin (1971 - 1972) apportent une définition, une description des traits caractéristiques de la bande dessinée et de son histoire, une réflexion sur sa popularité et sa réception. De plus, c'était une première tentative de sa part pour entreprendre une étude de son histoire et des conditions de son apparition en Pologne. Mais, en réalité, il ne put (ou ne voulut) se retenir d’exprimer des jugements de valeurs, inscrivant la bande dessinée ouvertement dans la tradition de la littérature peu ambitieuse, son jugement paraissant reposer sur la qualité selon lui insatisfaisante des publications polonaises.
La fin des années 70 et le début des années 80 impulsèrent un élan significatif à la réflexion sur la bande dessinée. Plusieurs nouveaux textes démontrèrent la connaissance extrêmement poussée de sujets y étant liés. Sławomir Magala analysa l’œuvre de Robert Crumb, représentant emblématique de l’Underground américain, en l’identifiant comme la troisième génération de la bande dessinée. Il fit de même avec Andrzej Mleczko, que le chercheur considérait comme l’équivalent polonais de R. Crumb. Sergiusz Sterna-Wachowiak et Ryszard Przybylski proposaient des analyses sémiotiques, Krzysztof Teodor Toeplitz publia les premiers extraits de son livre en préparation et la rédaction de la revue Le Cinéma dans le monde (Film na Świecie) consacra un numéro entier à la bande dessinée et à ses adaptations cinématographiques. L’attention du public fut captée par les dossiers spéciaux publiés dans la presse à l’époque. Malgré des opinions divergentes, ils provoquaient le même ressenti chez les chercheurs et les critiques qui, dans leurs analyses, déploraient leurs aspects stéréotypés et leur pédagogie primitive, ou les présentaient comme de parfaits exemples de propagande graphomane.
Le contexte d'alors était tel qu’en 1984 encore, dans Fantastyki, Maciej Parowski, un journaliste défenseur de la bande dessinée en tant qu'art, présenta une analyse amère de sa situation et réception critique en Pologne, réagissant contre les voix de lecteurs insatisfaits par les histoires publiées dans ce magazine. Il espérait cependant un changement imminent concernant cette discipline artistique, car en attente de la publication du livre de K.T. Toeplitz, annoncée depuis plusieurs années.
L’art de la bande dessinée. Tentative de définition d’un nouveau genre artistique (Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego) parut une année plus tard. Ce fut le premier et, pendant plus d’une décennie, le seul livre à constituer au fil des ans le socle de référence du savoir des chercheurs spécialisés. Il permit de combler une importante lacune dans la pensée polonaise, en se focalisant sur le langage de la bande dessinée et sa composante graphique, tout en accordant moins d’importance aux analyses sociologiques. K.T. Toeplitz propose une définition complexe, fondée sur l’étude de différentes composantes de la bande dessinée telles la conception des protagonistes, le rôle de l’espace dans la narration, celui du texte et des symboles. L’auteur se pose également la question de sa place parmi d’autres arts.
Les années 90 furent une période difficile pour la bande dessinée polonaise. Les brusques changements sociaux et économiques entrainés par la chute du régime communiste permirent de publier tout, sans limites ni censure. En conséquence, le marché national fut inondé de productions étrangères et la bande dessinée autochtone disparut pendant quasiment dix ans – en éditer n’était tout simplement pas viable économiquement. La situation força les créateurs à chercher des solutions de remplacement plus pérennes, dont les fanzines, ces petits magazines à tirage réduit dus aux artistes eux-mêmes et proposant, outre des bandes dessinées, des articles d’actualité. Le titre qui réussit à se distinguer des autres fut le magazine AQQ, fondé en 1993 par Witold Tkaczyk et Łukasz Zandecki, initialement publié en tant que fanzine et rapidement professionnalisé. Il fut le seul périodique consacré à la bande dessinée qui survit presque jusqu’au milieu des années 2010 et le seul à consacrer autant de place aux articles d’opinion et aux reportages. Il devint une sorte de chronique de la bande dessinée polonaise, procurant des comptes rendus exhaustifs des événements, des entretiens avec des personnalités du monde de la bande dessinée, des critiques des nouvelles publications. Il sauvegardait toutes les informations, même les plus insignifiantes, concernant la culture de la bande dessinée au sens large, complétées par des articles polémiques. Or, la grande persévérance dans la tenue des chroniques et le suivi de l’actualité, qui furent les atouts majeurs de AQQ durant les années 90, devinrent insuffisants face à l’arrivée des nouvelles technologies dans la décennie suivante. L’internet, en pleine expansion, s’imposa comme « la » source d’actualité. D’une certaine manière, l'arrêt de AQQ en 2004 acta symboliquement la séparation de deux domaines. Le journalisme, avec son actualité, s’installa durablement sur l'internet, tandis que la recherche conserva les formats traditionnels du magazine ou du livre. En cette même année virent le jour le principal portail numérique L’Allée de la bande dessinée (Aleja Komiksu) et le magazine papier Les Cahiers de la bande dessinée (Zeszyty Komiksowe).
Le début des années 90 fut aussi une période de recherche intense, voire intensifiée. Parurent notamment des articles de presse et scientifiques d’Adam Rusek, de Jerzy Szyłak et de Wojciech Birek. Aujourd’hui, ce sont des autorités incontestées dans le monde de la recherche en matière de bande dessinée. Ils y parvinrent par les voies classiques accessibles aux chercheurs, via la presse scientifique ou les publications collectives, principalement des comptes rendus de conférences. Mais ils empruntèrent également celles des parutions spécifiques au milieu, officieuses telles les fanzines ou tentant de fonctionner dans les conditions du marché, d'ailleurs pour la plupart sans succès.
Adam Rusek entreprit une tâche monumentale visant à retracer l’histoire de la bande dessinée polonaise. Jusque-là elle n’était connue que de manière rudimentaire, grâce à de rares descriptions ou listes superficielles se fondant sur des souvenirs ou des collections privées. Dans sa recherche, A. Rusek s’appuya sur des consultations fastidieuses et chronophages de la presse, qui exigèrent d’y consacrer des centaines d’heures de travail et de lire des dizaines de milliers de pages. Il partit, à juste titre, du constat que les réponses à ses questionnements sur les formes autochtones les plus anciennes de bandes dessinées devaient se trouver dans les pages des périodiques polonais.
Ce travail titanesque produisit des œuvres fondamentales, dont les titres mêmes dévoilent les hypothèses de recherche d'Adam Rusek. Il s’intéressa aux récits présentés sous forme d’une suite d’images, publiés en série. Il laissa donc de côté les œuvres uniques, sans suite. Ce chercheur se distingua par son choix de ne pas différencier des images à vocation narrative qui étaient les ancêtres de la bande dessinée polonaise ou des quasi-bandes dessinées de la bande dessinée « proprement dite », de facture plus actuelle, avec un texte placé dans la case. Ceci lui permit de mettre en évidence deux spécificités majeures en Pologne. D’un côté, il rendit visible la complexité de ce moyen d'expression, en prenant en compte les traits caractéristiques des histoires en images préfigurant la bande dessinée polonaise. Pour la plupart, celles-ci adoptaient une forme séquentielle, avec des images accompagnées de texte, souvent en vers, placé sous la case. De l’autre, il souligna leur continuité historique depuis les premières séries d’Artur Bartels et de Franciszek Kostrzewski au 19e siècle.
Aucun autre chercheur ne fit autant pour la bande dessinée polonaise et son étude historique. Adam Rusek vérifia et révisa les mythes et conceptions existants dans ce milieu, sauvant de l’oubli de nombreux noms et titres, par la publication d'extraits ou d'œuvres complètes, voire l’édition de la collection anthologique L’ancienne bande dessinée polonaise (Dawny komiks polski), qui compte à ce jour quatre volumes. Mais il découvrit aussi beaucoup de créateurs et de travaux que personne avant lui ne connaissait, en révélant tout des noms cachés derrière les pseudonymes, des événements de la vie des auteurs, des références, des adaptations et des emprunts. En premier lieu, il dévoila au grand jour l’ampleur réelle de la présence de la bande dessinée en Pologne avant et après la Seconde Guerre mondiale, toutes les analyses s’appuyant sur de longues bibliographies. En outre, la bande dessinée telle que présentée par A. Rusek est un phénomène vivant, enraciné dans le monde réel, profondément ancré dans les différents contextes sociaux et politiques, réactif aux changements qu'ils engendrent, sinon souvent leur victime.
Jerzy Szyłak est sans doute le plus prolifique des chercheurs polonais spécialisés en bande dessinée. Lui-même choisit de se définir comme un expert en cinéma. Cependant, ses publications sur la bande dessinée dépassent le nombre de celles consacrées au septième art. Ses premiers textes parurent au début des années 80, en majorité dans la presse. Son activité de recherche ne commença vraiment que durant la décennie suivante, son premier livre sortant en 1996. Sa position ne se pérennisa qu'à la fin du 20e – début 21e siècle, surtout grâce à la publication de la trilogie La bande dessinée, le monde surdessiné (Komiks : świat przerysowany, 1998), La bande dessinée dans la culture iconique du 20e siècle (Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, 1999) et La poésie de la bande dessinée. Dimension symbolique et linguistique (Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, 2000). La lecture de ce dernier ouvrage devint un élément indispensable dans la formation de tout nouvel apprenti-chercheur polonais en bande dessinée. En effet, ces livres présentent au lecteur une vision complexe et réfléchie. Ils le font en partant de la base, des éléments constitutifs des images narratives préfigurant la bande dessinée, en passant par les traits caractéristiques de cette dernière en tant que moyen d'expression. Ceci aboutit en définitive à la situer vis-à-vis d’autres disciplines artistiques et identifier sa place et son rôle dans l’histoire de la culture.
Les livres précités et l'ascendant immédiat pris par J. Szyłak dans l’étude de la bande dessinée polonaise furent suivis par des publications qui lui apportèrent la consécration. Dans celles-ci, l’auteur explora ses principaux domaines d’intérêt, les aspects sombres de la sexualité liés à la violence physique et mentale, ainsi que le rapport entre la bande dessinée et le cinéma. J. Szyłak a également rédigé la première œuvre de vulgarisation destinée au grand public, présentant de façon simple les images narratives pionnières du neuvième art en Pologne. Il s’agit de son seul texte non scientifique. À ce jour il n’y a que trois publications de ce genre dans le pays, dont son ouvrage.
La position dominante de J. Szyłak ne suscitait cependant pas une acceptation sans contestation de ses postulats. Certes, ses hypothèses fortes et bien fondées invitaient au débat, mais sans pour autant rendre aisée la polémique. Il reçut la formation d’un critique littéraire. Cela faisait donc de lui aussi le défenseur du caractère pertinent du rôle joué par les critiques littéraires dans l’étude de l’art de la bande dessinée, ainsi que de la thèse concevant cette dernière et les lettres comme des arts voisins. Comme de nombreux autres critiques littéraires, on l’accusait de vouloir accaparer la bande dessinée et de simplifier le débat par l’adoption d’une perspective unique réduite, empêchant ainsi, selon ses contradicteurs, d’analyser la bande dessinée de façon adéquate. Ce conflit s’intensifia pendant plus de dix ans et fut alimenté surtout par le plus grand partisan de la création de ce nouveau domaine scientifique, l’étude critique de la bande dessinée. Il s'agissait de Krzysztof Skrzypczyk, organisateur de séminaires la concernant. Ils se tinrent, de 2001 à 2012, en lien avec le Festival International de la bande dessinée et des jeux de Łódź, des recueils en rassemblant les débats. Après quelques tentatives de dialogue, J. Szyłak adopta assez rapidement une position attentiste. Pendant cette période, il ne fit paraître, hormis des articles, que des rééditions de deux de ses livres et un florilège de ses publications à suivre sur l'internet et des extraits de projets inachevés. Il finit par se prononcer dans l'ouvrage La bande dessinée prise au piège de la médiocrité. Dissertations et études (Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice, 2013) consacré à ce qu'il considérait comme l’avilissement de l'étude critique sur la bande dessinée. Il y règle ses comptes à ce sujet et avec le concept de story art de Jakub Woynarowski.
Durant les années suivantes, J. Szyłak se pencha sur d’autres sujets, participant à l’idée et à la conception d'un dictionnaire sur le roman graphique, écrivant un livre consacré à ses limites et élargissant son cercle d’intérêt aux picture books. Citons simplement les trois volumes d'un dictionnaire en cours sur les livres illustrés dont il est l'éditeur et le co-auteur.
De son côté, Wojciech Birek dut beaucoup attendre avant sa première publication. Cependant, dès la fin des années 80 (?) ce chercheur contribuait activement à la promotion du neuvième art grâce à ses propres créations, publications et traductions dans le domaine, ne se limitant pas à ce secteur. Outre un millier de bandes dessinées, il a notamment traduit du français au polonais Grzegorz Rosiński : monographie de Patrick Gaumer et Piotr Rosiński (2015) et Système de la bande dessinée de Thierry Groensteen, toujours en attente de parution. La plupart des études scientifiques de W. Birek ont paru dans des ouvrages collectifs et dans la presse spécialisée, raison pour laquelle ce volet de son activité resta longtemps inconnu dans le milieu de la bande dessinée.
Cela changea en 2014 grâce au livre La Théorie et la pratique de la bande dessinée. Suggestions et remarques (Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje), rassemblant une bonne partie de ses articles divers. Mais on dut attendre 2018 pour enfin voir arriver son œuvre majeure, à savoir le livre Henryk Sienkiewicz en images. Les dessins de Henryk Sienkiewicz et les adaptations graphiques de ses romans (Henryk Sienkiewicz w obrazkach. Rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści). Cet ouvrage de référence lié au Prix Nobel de littérature polonais 1905 fut le couronnement de longues années d’études et de recherches menées à travers le monde.
La période récente se caractérise par une intense activité critique et théorique, y compris parmi les jeunes chercheurs qui s’approprient de nouveaux domaines ou rajoutent leur pierre à l’édifice des sujets déjà abordés. Citons ici la sortie de livres consacrés, entre autres, à la bande dessinée historique, aux super-héros, à leurs sources d'inspiration mythiques (mais pas uniquement), ainsi que d'études privilégiant les approches cognitives. Sont également publiés plus ou moins régulièrement des travaux collectifs, fruits de conférences et de cours magistraux organisés à Poznań. En dehors des milieux universitaires ou reconnus de la recherche sur la bande dessinée, des auteurs sans formation scientifique sont néanmoins très actifs. Ils sont à l'origine de parutions consacrées à la bande dessinée de la région de la Sainte-Croix, l'un des principaux centre de pèlerinage de Pologne et un endroit réputé pour ses légendes folkloriques. Ils reviennent sur les débuts des romans graphiques polonais, sur Jerzy Wróblewski et les titres de la période communiste, voire l'analyse de séries célèbres d'alors comme Capitaine Chat Sauvage (Kapitan Żbik) et sur le magazine Relax. La plupart de ces livres sont empreints d'un sentiment de nostalgie par rapport aux créateurs et aux œuvres de l'époque communiste, d'avant les changements politiques en Pologne.
De temps à autre paraissent des dossiers thématiques d’étude de la bande dessinée dans la presse spécialisée, à vocation didactique, littéraire, culturelle. Mais il existe également un magazine entièrement consacré au neuvième art. Les Cahiers de la bande dessinée, fondés en 2004, proposent dès leurs débuts des dossiers monographiques. C’est le seul magazine de ce type en Pologne, publiant dans ses pages non seulement les textes de quasiment tous les chercheurs polonais, mais des traductions issues de plusieurs langues étrangères.
Outre les titres strictement scientifiques ou commerciaux, comptant de rares parutions entièrement consacrées à la bande dessinée, les livres sur ce thème sont publiés par des maisons d’édition spécialisées dans le neuvième art comme Centrala, Timof Comics, ayant notamment traduit le livre Comics Versus Art de Bart Beaty, ou Kurc. Depuis 2015, la position de leader dans le domaine de l’édition de ce genre d'ouvrages est occupée par l'Institut de Culture populaire (Instytut Kultury Popularnej), éditeur des Cahiers de la bande dessinée depuis la même année. Durant cette période parurent quatorze éditions des Cahiers et six tirages additionnels. Le magazine est co-publié avec la bibliothèque de l'université de Poznań (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier l’activité organisationnelle de divers organismes, souvent liée à la réalisation de projets d’édition, tel le cas précité de l'Institut de Culture populaire, projet éditorial de la Fondation de l'Institut de Culture populaire (Fundacja Instytut Kultury Popularnej). Il convient également de mettre en avant l’action de la Galerie BWA de Jelenia Góra. Les expositions monographiques ou transversales organisées par le commissaire d'exposition Piotr Machłajewski sont accompagnées de catalogues. Ceux-ci en dépassent souvent le cadre standard, tant par leur ampleur que par leur approche. Il s’agit plutôt d'ouvrages monographiques, voire de livres que l’on classerait d'ordinaire difficilement dans la catégorie des catalogues. Cette caractéristique se retrouve avec la publication bilingue Comics now ! accompagnant l’exposition organisée par le Musée National de Cracovie en 2018, qui combinait une envergure relevant du catalogue raisonné et analyse en profondeur du sujet.
Il serait également judicieux de mentionner les livres promouvant le patrimoine de la bande dessinée polonaise à l’étranger. Ainsi, Histoire de la bande dessinée polonaise (2020) est un ouvrage collectif d'auteurs polonais s'adressant au public francophone, paru aux Éditions P.L.G.. Tandis que deux publications existent en langue allemande, Comic in Polen – Polen im Comic (2016) et Handbuch polnische Comickulturen nach 1989 (2021) par Kalina Kapuczynska et Renata Makarska, chez Christian A. Bachmann Verlag.
L’état d’avancement actuel de la pensée critique et théorique dans le domaine de la bande dessinée comparé à celui d’il y a trente ans ne laisse pas de doute quant au gigantesque bond effectué. La nouvelle réalité sociale et politique, ainsi que les nouvelles possibilités cognitives contribuent à améliorer sans cesse les connaissances des Polonais en la matière. Même si cette évolution n'est pas aussi rapide que nous ne le souhaiterions, de plus en plus de gens en Pologne se rendent compte de la valeur et de la diversité du neuvième art. Cela se traduit tant par le nombre de jeunes chercheurs intéressés par les sujets du domaine de la bande dessinée que par celui des nouvelles publications. Il est vrai qu’il reste encore beaucoup de travail à effectuer, mais aujourd’hui nous pouvons être confiants. Ce n'est plus qu’une question de temps avant de rattraper le retard accumulé depuis de nombreuses années.
Michał Traczyk
En Pologne, avant la Seconde Guerre mondiale, les histoires en images avec du texte placé sous la case jouissaient d’une grande popularité auprès des lecteurs. Elles paraissaient surtout dans la presse, en améliorant les ventes, raison pour laquelle ces publications étaient assez nombreuses. Comme l’objectif premier de la bande dessinée polonaise consistait alors à divertir, leurs auteurs ne prenaient pas toujours ce volet de leur activité au sérieux. Les critiques, dans la mesure où il la remarquaient, ne faisaient pas grand cas de sa valeur artistique et culturelle. Ils préféraient se focaliser sur la présence importante des comic strips dans la presse anglophone.
L’intérêt pour la bande dessinée augmenta après le conflit, mais plutôt que pour ses qualités artistiques, à cause du nouveau contexte de guerre froide et de ses enjeux politiques et idéologiques. La presse polonaise y voyait une source de l’effondrement moral des Américains et du fort taux de délinquance juvénile chez eux. Selon ses journalistes, ces récits en images étaient tous, sans exception, vulgaires et puérils, facteurs d’analphabétisme et de racisme, influençant les jeunes esprits et les subjuguant tel un narcotique.
Cette ligne directrice de la critique de la période d'après-guerre s’ancra pour longtemps dans la conscience collective. L’image d'une bande dessinée vue comme un support vide véhiculant des contenus superficiels et dangereux ne pouvait être inversée par les rares analyses de fond, au degré d’exactitude variable, s’écartant du principe dominant. Citons pourtant celle d’Aleksander Hertz publiée dans Kuźnica en 1947 – dans laquelle le sociologue a reconnu dans les bandes dessinées une variété de contes se référant aux mythes et aux valeurs qui sont importants pour la société américaine. Une petite histoire de la bande dessinée (Mała historia komiksów, 1964) d’Andrzej Banach contient non seulement une comparaison extrêmement périlleuse entre différents genres de la bande dessinée et ceux de la littérature (épique, dramatique et lyrique), mais fait également remonter ses débuts à l’Égypte ancienne. Les articles de Janusz Dunin (1971 - 1972) apportent une définition, une description des traits caractéristiques de la bande dessinée et de son histoire, une réflexion sur sa popularité et sa réception. De plus, c'était une première tentative de sa part pour entreprendre une étude de son histoire et des conditions de son apparition en Pologne. Mais, en réalité, il ne put (ou ne voulut) se retenir d’exprimer des jugements de valeurs, inscrivant la bande dessinée ouvertement dans la tradition de la littérature peu ambitieuse, son jugement paraissant reposer sur la qualité selon lui insatisfaisante des publications polonaises.
La fin des années 70 et le début des années 80 impulsèrent un élan significatif à la réflexion sur la bande dessinée. Plusieurs nouveaux textes démontrèrent la connaissance extrêmement poussée de sujets y étant liés. Sławomir Magala analysa l’œuvre de Robert Crumb, représentant emblématique de l’Underground américain, en l’identifiant comme la troisième génération de la bande dessinée. Il fit de même avec Andrzej Mleczko, que le chercheur considérait comme l’équivalent polonais de R. Crumb. Sergiusz Sterna-Wachowiak et Ryszard Przybylski proposaient des analyses sémiotiques, Krzysztof Teodor Toeplitz publia les premiers extraits de son livre en préparation et la rédaction de la revue Le Cinéma dans le monde (Film na Świecie) consacra un numéro entier à la bande dessinée et à ses adaptations cinématographiques. L’attention du public fut captée par les dossiers spéciaux publiés dans la presse à l’époque. Malgré des opinions divergentes, ils provoquaient le même ressenti chez les chercheurs et les critiques qui, dans leurs analyses, déploraient leurs aspects stéréotypés et leur pédagogie primitive, ou les présentaient comme de parfaits exemples de propagande graphomane.
Le contexte d'alors était tel qu’en 1984 encore, dans Fantastyki, Maciej Parowski, un journaliste défenseur de la bande dessinée en tant qu'art, présenta une analyse amère de sa situation et réception critique en Pologne, réagissant contre les voix de lecteurs insatisfaits par les histoires publiées dans ce magazine. Il espérait cependant un changement imminent concernant cette discipline artistique, car en attente de la publication du livre de K.T. Toeplitz, annoncée depuis plusieurs années.
L’art de la bande dessinée. Tentative de définition d’un nouveau genre artistique (Sztuka komiksu. Próba definicji nowego gatunku artystycznego) parut une année plus tard. Ce fut le premier et, pendant plus d’une décennie, le seul livre à constituer au fil des ans le socle de référence du savoir des chercheurs spécialisés. Il permit de combler une importante lacune dans la pensée polonaise, en se focalisant sur le langage de la bande dessinée et sa composante graphique, tout en accordant moins d’importance aux analyses sociologiques. K.T. Toeplitz propose une définition complexe, fondée sur l’étude de différentes composantes de la bande dessinée telles la conception des protagonistes, le rôle de l’espace dans la narration, celui du texte et des symboles. L’auteur se pose également la question de sa place parmi d’autres arts.
Les années 90 furent une période difficile pour la bande dessinée polonaise. Les brusques changements sociaux et économiques entrainés par la chute du régime communiste permirent de publier tout, sans limites ni censure. En conséquence, le marché national fut inondé de productions étrangères et la bande dessinée autochtone disparut pendant quasiment dix ans – en éditer n’était tout simplement pas viable économiquement. La situation força les créateurs à chercher des solutions de remplacement plus pérennes, dont les fanzines, ces petits magazines à tirage réduit dus aux artistes eux-mêmes et proposant, outre des bandes dessinées, des articles d’actualité. Le titre qui réussit à se distinguer des autres fut le magazine AQQ, fondé en 1993 par Witold Tkaczyk et Łukasz Zandecki, initialement publié en tant que fanzine et rapidement professionnalisé. Il fut le seul périodique consacré à la bande dessinée qui survit presque jusqu’au milieu des années 2010 et le seul à consacrer autant de place aux articles d’opinion et aux reportages. Il devint une sorte de chronique de la bande dessinée polonaise, procurant des comptes rendus exhaustifs des événements, des entretiens avec des personnalités du monde de la bande dessinée, des critiques des nouvelles publications. Il sauvegardait toutes les informations, même les plus insignifiantes, concernant la culture de la bande dessinée au sens large, complétées par des articles polémiques. Or, la grande persévérance dans la tenue des chroniques et le suivi de l’actualité, qui furent les atouts majeurs de AQQ durant les années 90, devinrent insuffisants face à l’arrivée des nouvelles technologies dans la décennie suivante. L’internet, en pleine expansion, s’imposa comme « la » source d’actualité. D’une certaine manière, l'arrêt de AQQ en 2004 acta symboliquement la séparation de deux domaines. Le journalisme, avec son actualité, s’installa durablement sur l'internet, tandis que la recherche conserva les formats traditionnels du magazine ou du livre. En cette même année virent le jour le principal portail numérique L’Allée de la bande dessinée (Aleja Komiksu) et le magazine papier Les Cahiers de la bande dessinée (Zeszyty Komiksowe).
Le début des années 90 fut aussi une période de recherche intense, voire intensifiée. Parurent notamment des articles de presse et scientifiques d’Adam Rusek, de Jerzy Szyłak et de Wojciech Birek. Aujourd’hui, ce sont des autorités incontestées dans le monde de la recherche en matière de bande dessinée. Ils y parvinrent par les voies classiques accessibles aux chercheurs, via la presse scientifique ou les publications collectives, principalement des comptes rendus de conférences. Mais ils empruntèrent également celles des parutions spécifiques au milieu, officieuses telles les fanzines ou tentant de fonctionner dans les conditions du marché, d'ailleurs pour la plupart sans succès.
Adam Rusek entreprit une tâche monumentale visant à retracer l’histoire de la bande dessinée polonaise. Jusque-là elle n’était connue que de manière rudimentaire, grâce à de rares descriptions ou listes superficielles se fondant sur des souvenirs ou des collections privées. Dans sa recherche, A. Rusek s’appuya sur des consultations fastidieuses et chronophages de la presse, qui exigèrent d’y consacrer des centaines d’heures de travail et de lire des dizaines de milliers de pages. Il partit, à juste titre, du constat que les réponses à ses questionnements sur les formes autochtones les plus anciennes de bandes dessinées devaient se trouver dans les pages des périodiques polonais.
Ce travail titanesque produisit des œuvres fondamentales, dont les titres mêmes dévoilent les hypothèses de recherche d'Adam Rusek. Il s’intéressa aux récits présentés sous forme d’une suite d’images, publiés en série. Il laissa donc de côté les œuvres uniques, sans suite. Ce chercheur se distingua par son choix de ne pas différencier des images à vocation narrative qui étaient les ancêtres de la bande dessinée polonaise ou des quasi-bandes dessinées de la bande dessinée « proprement dite », de facture plus actuelle, avec un texte placé dans la case. Ceci lui permit de mettre en évidence deux spécificités majeures en Pologne. D’un côté, il rendit visible la complexité de ce moyen d'expression, en prenant en compte les traits caractéristiques des histoires en images préfigurant la bande dessinée polonaise. Pour la plupart, celles-ci adoptaient une forme séquentielle, avec des images accompagnées de texte, souvent en vers, placé sous la case. De l’autre, il souligna leur continuité historique depuis les premières séries d’Artur Bartels et de Franciszek Kostrzewski au 19e siècle.
Aucun autre chercheur ne fit autant pour la bande dessinée polonaise et son étude historique. Adam Rusek vérifia et révisa les mythes et conceptions existants dans ce milieu, sauvant de l’oubli de nombreux noms et titres, par la publication d'extraits ou d'œuvres complètes, voire l’édition de la collection anthologique L’ancienne bande dessinée polonaise (Dawny komiks polski), qui compte à ce jour quatre volumes. Mais il découvrit aussi beaucoup de créateurs et de travaux que personne avant lui ne connaissait, en révélant tout des noms cachés derrière les pseudonymes, des événements de la vie des auteurs, des références, des adaptations et des emprunts. En premier lieu, il dévoila au grand jour l’ampleur réelle de la présence de la bande dessinée en Pologne avant et après la Seconde Guerre mondiale, toutes les analyses s’appuyant sur de longues bibliographies. En outre, la bande dessinée telle que présentée par A. Rusek est un phénomène vivant, enraciné dans le monde réel, profondément ancré dans les différents contextes sociaux et politiques, réactif aux changements qu'ils engendrent, sinon souvent leur victime.
Jerzy Szyłak est sans doute le plus prolifique des chercheurs polonais spécialisés en bande dessinée. Lui-même choisit de se définir comme un expert en cinéma. Cependant, ses publications sur la bande dessinée dépassent le nombre de celles consacrées au septième art. Ses premiers textes parurent au début des années 80, en majorité dans la presse. Son activité de recherche ne commença vraiment que durant la décennie suivante, son premier livre sortant en 1996. Sa position ne se pérennisa qu'à la fin du 20e – début 21e siècle, surtout grâce à la publication de la trilogie La bande dessinée, le monde surdessiné (Komiks : świat przerysowany, 1998), La bande dessinée dans la culture iconique du 20e siècle (Komiks w kulturze ikonicznej XX wieku, 1999) et La poésie de la bande dessinée. Dimension symbolique et linguistique (Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa, 2000). La lecture de ce dernier ouvrage devint un élément indispensable dans la formation de tout nouvel apprenti-chercheur polonais en bande dessinée. En effet, ces livres présentent au lecteur une vision complexe et réfléchie. Ils le font en partant de la base, des éléments constitutifs des images narratives préfigurant la bande dessinée, en passant par les traits caractéristiques de cette dernière en tant que moyen d'expression. Ceci aboutit en définitive à la situer vis-à-vis d’autres disciplines artistiques et identifier sa place et son rôle dans l’histoire de la culture.
Les livres précités et l'ascendant immédiat pris par J. Szyłak dans l’étude de la bande dessinée polonaise furent suivis par des publications qui lui apportèrent la consécration. Dans celles-ci, l’auteur explora ses principaux domaines d’intérêt, les aspects sombres de la sexualité liés à la violence physique et mentale, ainsi que le rapport entre la bande dessinée et le cinéma. J. Szyłak a également rédigé la première œuvre de vulgarisation destinée au grand public, présentant de façon simple les images narratives pionnières du neuvième art en Pologne. Il s’agit de son seul texte non scientifique. À ce jour il n’y a que trois publications de ce genre dans le pays, dont son ouvrage.
La position dominante de J. Szyłak ne suscitait cependant pas une acceptation sans contestation de ses postulats. Certes, ses hypothèses fortes et bien fondées invitaient au débat, mais sans pour autant rendre aisée la polémique. Il reçut la formation d’un critique littéraire. Cela faisait donc de lui aussi le défenseur du caractère pertinent du rôle joué par les critiques littéraires dans l’étude de l’art de la bande dessinée, ainsi que de la thèse concevant cette dernière et les lettres comme des arts voisins. Comme de nombreux autres critiques littéraires, on l’accusait de vouloir accaparer la bande dessinée et de simplifier le débat par l’adoption d’une perspective unique réduite, empêchant ainsi, selon ses contradicteurs, d’analyser la bande dessinée de façon adéquate. Ce conflit s’intensifia pendant plus de dix ans et fut alimenté surtout par le plus grand partisan de la création de ce nouveau domaine scientifique, l’étude critique de la bande dessinée. Il s'agissait de Krzysztof Skrzypczyk, organisateur de séminaires la concernant. Ils se tinrent, de 2001 à 2012, en lien avec le Festival International de la bande dessinée et des jeux de Łódź, des recueils en rassemblant les débats. Après quelques tentatives de dialogue, J. Szyłak adopta assez rapidement une position attentiste. Pendant cette période, il ne fit paraître, hormis des articles, que des rééditions de deux de ses livres et un florilège de ses publications à suivre sur l'internet et des extraits de projets inachevés. Il finit par se prononcer dans l'ouvrage La bande dessinée prise au piège de la médiocrité. Dissertations et études (Komiks w szponach miernoty. Rozprawy i szkice, 2013) consacré à ce qu'il considérait comme l’avilissement de l'étude critique sur la bande dessinée. Il y règle ses comptes à ce sujet et avec le concept de story art de Jakub Woynarowski.
Durant les années suivantes, J. Szyłak se pencha sur d’autres sujets, participant à l’idée et à la conception d'un dictionnaire sur le roman graphique, écrivant un livre consacré à ses limites et élargissant son cercle d’intérêt aux picture books. Citons simplement les trois volumes d'un dictionnaire en cours sur les livres illustrés dont il est l'éditeur et le co-auteur.
De son côté, Wojciech Birek dut beaucoup attendre avant sa première publication. Cependant, dès la fin des années 80 (?) ce chercheur contribuait activement à la promotion du neuvième art grâce à ses propres créations, publications et traductions dans le domaine, ne se limitant pas à ce secteur. Outre un millier de bandes dessinées, il a notamment traduit du français au polonais Grzegorz Rosiński : monographie de Patrick Gaumer et Piotr Rosiński (2015) et Système de la bande dessinée de Thierry Groensteen, toujours en attente de parution. La plupart des études scientifiques de W. Birek ont paru dans des ouvrages collectifs et dans la presse spécialisée, raison pour laquelle ce volet de son activité resta longtemps inconnu dans le milieu de la bande dessinée.
Cela changea en 2014 grâce au livre La Théorie et la pratique de la bande dessinée. Suggestions et remarques (Z teorii i praktyki komiksu. Propozycje i obserwacje), rassemblant une bonne partie de ses articles divers. Mais on dut attendre 2018 pour enfin voir arriver son œuvre majeure, à savoir le livre Henryk Sienkiewicz en images. Les dessins de Henryk Sienkiewicz et les adaptations graphiques de ses romans (Henryk Sienkiewicz w obrazkach. Rysunki Henryka Sienkiewicza i obrazkowe adaptacje jego powieści). Cet ouvrage de référence lié au Prix Nobel de littérature polonais 1905 fut le couronnement de longues années d’études et de recherches menées à travers le monde.
La période récente se caractérise par une intense activité critique et théorique, y compris parmi les jeunes chercheurs qui s’approprient de nouveaux domaines ou rajoutent leur pierre à l’édifice des sujets déjà abordés. Citons ici la sortie de livres consacrés, entre autres, à la bande dessinée historique, aux super-héros, à leurs sources d'inspiration mythiques (mais pas uniquement), ainsi que d'études privilégiant les approches cognitives. Sont également publiés plus ou moins régulièrement des travaux collectifs, fruits de conférences et de cours magistraux organisés à Poznań. En dehors des milieux universitaires ou reconnus de la recherche sur la bande dessinée, des auteurs sans formation scientifique sont néanmoins très actifs. Ils sont à l'origine de parutions consacrées à la bande dessinée de la région de la Sainte-Croix, l'un des principaux centre de pèlerinage de Pologne et un endroit réputé pour ses légendes folkloriques. Ils reviennent sur les débuts des romans graphiques polonais, sur Jerzy Wróblewski et les titres de la période communiste, voire l'analyse de séries célèbres d'alors comme Capitaine Chat Sauvage (Kapitan Żbik) et sur le magazine Relax. La plupart de ces livres sont empreints d'un sentiment de nostalgie par rapport aux créateurs et aux œuvres de l'époque communiste, d'avant les changements politiques en Pologne.
De temps à autre paraissent des dossiers thématiques d’étude de la bande dessinée dans la presse spécialisée, à vocation didactique, littéraire, culturelle. Mais il existe également un magazine entièrement consacré au neuvième art. Les Cahiers de la bande dessinée, fondés en 2004, proposent dès leurs débuts des dossiers monographiques. C’est le seul magazine de ce type en Pologne, publiant dans ses pages non seulement les textes de quasiment tous les chercheurs polonais, mais des traductions issues de plusieurs langues étrangères.
Outre les titres strictement scientifiques ou commerciaux, comptant de rares parutions entièrement consacrées à la bande dessinée, les livres sur ce thème sont publiés par des maisons d’édition spécialisées dans le neuvième art comme Centrala, Timof Comics, ayant notamment traduit le livre Comics Versus Art de Bart Beaty, ou Kurc. Depuis 2015, la position de leader dans le domaine de l’édition de ce genre d'ouvrages est occupée par l'Institut de Culture populaire (Instytut Kultury Popularnej), éditeur des Cahiers de la bande dessinée depuis la même année. Durant cette période parurent quatorze éditions des Cahiers et six tirages additionnels. Le magazine est co-publié avec la bibliothèque de l'université de Poznań (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu).
Dans ce contexte, il ne faut pas oublier l’activité organisationnelle de divers organismes, souvent liée à la réalisation de projets d’édition, tel le cas précité de l'Institut de Culture populaire, projet éditorial de la Fondation de l'Institut de Culture populaire (Fundacja Instytut Kultury Popularnej). Il convient également de mettre en avant l’action de la Galerie BWA de Jelenia Góra. Les expositions monographiques ou transversales organisées par le commissaire d'exposition Piotr Machłajewski sont accompagnées de catalogues. Ceux-ci en dépassent souvent le cadre standard, tant par leur ampleur que par leur approche. Il s’agit plutôt d'ouvrages monographiques, voire de livres que l’on classerait d'ordinaire difficilement dans la catégorie des catalogues. Cette caractéristique se retrouve avec la publication bilingue Comics now ! accompagnant l’exposition organisée par le Musée National de Cracovie en 2018, qui combinait une envergure relevant du catalogue raisonné et analyse en profondeur du sujet.
Il serait également judicieux de mentionner les livres promouvant le patrimoine de la bande dessinée polonaise à l’étranger. Ainsi, Histoire de la bande dessinée polonaise (2020) est un ouvrage collectif d'auteurs polonais s'adressant au public francophone, paru aux Éditions P.L.G.. Tandis que deux publications existent en langue allemande, Comic in Polen – Polen im Comic (2016) et Handbuch polnische Comickulturen nach 1989 (2021) par Kalina Kapuczynska et Renata Makarska, chez Christian A. Bachmann Verlag.
L’état d’avancement actuel de la pensée critique et théorique dans le domaine de la bande dessinée comparé à celui d’il y a trente ans ne laisse pas de doute quant au gigantesque bond effectué. La nouvelle réalité sociale et politique, ainsi que les nouvelles possibilités cognitives contribuent à améliorer sans cesse les connaissances des Polonais en la matière. Même si cette évolution n'est pas aussi rapide que nous ne le souhaiterions, de plus en plus de gens en Pologne se rendent compte de la valeur et de la diversité du neuvième art. Cela se traduit tant par le nombre de jeunes chercheurs intéressés par les sujets du domaine de la bande dessinée que par celui des nouvelles publications. Il est vrai qu’il reste encore beaucoup de travail à effectuer, mais aujourd’hui nous pouvons être confiants. Ce n'est plus qu’une question de temps avant de rattraper le retard accumulé depuis de nombreuses années.


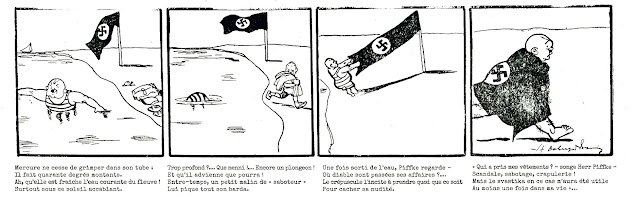

Komentarze
Prześlij komentarz