Différentes formes d'histoires en images en Pologne du Moyen Âge jusqu’au 19e siècle.
Différentes formes d'histoires en images en Pologne du Moyen Âge jusqu’au 19e siècle
Paweł Chmielewski
Les manuscrits enluminés médiévaux européens se distinguaient par leur picturalité. Ils étaient fortement inspirés, après la fin du 11e siècle, par les réalisations artistiques de l’Orient antique découvertes au début des croisades. Cette influence se retrouva surtout dans des cycles d’illustrations, y compris en Pologne. Des enluminures à vocation narrative ornent les pages des plus vieux codexes de l’art roman, parmi lesquels il convient de mentionner l’Évangéliaire de Plock (Ewangelistarz płocki), connu aussi d'après le nom de l’endroit de sa conservation, en tant que Codex de Pultusk(Kodeks pułtuski). Ce « manuel » pour prêtres et ses illustrations furent créés peu après 1075. Le Codex doré de Gniezno (Złoty kodeks gnieźnieński) est daté généralement de la même époque et la Bible de Czerwien (Biblia czerwieńska), produite durant le siècle suivant, fut perdue lors de l'Insurrection de Varsovie (1944). Le parchemin ne fut pas toujours le support sur lequel on immortalisa les récits narrés en images. La représentation la plus ancienne – parmi celles connues à ce jour en Pologne – dévoile huit scènes de la vie de Gédéon, personnage issu de l’Ancien testament, gravées au 10e siècle sur les parois de la « coupe de Wroclaw ». L’exemple le plus célèbre et le plus sophistiqué annonçant l’art séquentiel sont les deux pans moulés en bronze de la porte de la cathédrale de Gniezno, datant d'environ 1170. Ils illustrent en deux panneaux horizontaux de neuf « cadres » la vie et la mort de Saint Adalbert.
Durant la période que Johan Huizinga appela « L’Automne du Moyen Âge », à Cracovie, alors la capitale du royaume de Pologne, fonctionnaient des imprimeries dont les livres ornés de récits en images jouissaient d’un grand succès. Aujourd’hui nous pourrions les définir comme des précurseurs de la bande dessinée. Il convient d'en énumérer ici quelques-uns. La première de ces publications prenait pour modèle la forme connue des « Bibles des pauvres » néerlandaises et allemandes. Intitulée l'Évangéliaire d’Ungler (Ewangeliarz Unglera) et due à Jan de Sącz (alias Johannes Maletius, 1482-1567), elle fut imprimée vers 1527. En 1561, les héritiers de l’imprimeur cracovien le plus connu de l’époque, Marek Szarfenberg (vers 1490-1545), confectionnèrent la Bible dite du Léopolite (Biblia Leopolity). Ses 1266 pages contiennent pas moins de 296 gravures accompagnées de leurs descriptions. Dans ce volumineux ouvrage, qui constitue également l'un des monuments de la langue polonaise, le gros des illustrations se trouve dans l’Apocalypse de saint Jean. Cette partie mystérieuse et riche en symboles du Nouveau Testament fut ornée de vingt-six gravures sur bois. Celles-ci composent une œuvre graphique et narrative uniforme. Elles se caractérisent par un grand dynamisme, représentant des personnages fantastiques et dotés de caractéristiques distinctes, ainsi que des phénomènes surnaturels, avec des revirements soudains et une trame cohérente grâce à un écoulement du temps marqué. Ces gravures sont accompagnées par de courts textes dépeignant le contenu des images. Et complétons leur analyse par deux caractéristiques relevant du domaine de la théorie de la bande dessinée – elles constituent une œuvre populaire et largement accessible. Les derniers représentants des formes cracoviennes de récits en images de l’époque de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance sont Le Codex de Balthasar Behem (Kodeks Baltazara Behemade, 1505), par un artiste anonyme imitant le style pictural de Jérôme Bosch, ainsi que les calendriers illustrés et les recueils de prémonitions créés par l’astronome et professeur Michał de Wiślica (vers 1499-1575), de l’Académie de Cracovie. Citons encore, issue de la littérature « vulgaire », l’œuvre satirique de Jan de Koszyczki (vers 1488-1546), Les conversations du sage Roy Salomon avec Marcholt gros et obscène (Rozmowy które myał Król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym, 1521). Elle contient une série d’illustrations d’un graveur anonyme.
Parmi d'autres graveurs et les imprimeurs de l’époque qui choisirent l’émigration, on trouve Jan Ziarnko (1575-1626). Le nom de ce peintre originaire de Lviv figure parmi les six illustrateurs des cycles contenus dans le livre français richement illustré Les peintures sacrées sur la Bible (1665), dont le jésuite Antoine Girard fut l’éditeur et l’auteur de la préface. J. Ziarnko décéda avant sa publication, mais les notes contenues dans les commentaires de l'ouvrage prouvent qu’il jouissait d’une certaine renommée en France.
Parmi les créations qui pavèrent le chemin de la bande dessinée de presse, il convient de se pencher sur les journaux de mode du 17e siècle. C’est dans ce cadre et au moyen d'un style esthétique baroque proche de celui des précurseurs de la bande dessinée allemande et française qu'un habitant de Dantzig, Anton Möller (vers 1563-1611), créa Les habits de tous les états… (Wszystkich stanów ubrania...,1601). Ses vingt gravures annotées présentaient des modèles, de manière remarquable, de différents points de vue, de profil, de semi-profil, de dos, anticipant véritablement le travail d'un photographe. Elles présentaient un profil social complet des personnages de Dantzig, des domestiques et citadines pauvres jusqu’aux femmes de banquiers et de riches patriciennes.
Dantzig fut aussi la ville natale de Daniel Mikołaj Chodowiecki(1726-1801). Ce fils d’un polonais et d’une huguenote suisse devint l'illustrateur des livres les plus convoités sur le marché allemand. Ses gravures pour La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, les œuvres de Gotthold Ephraim Lessing et des romans populaires pérennisèrent sa notoriété. Durant les guerres napoléoniennes, les soldats britanniques ramenèrent les ouvrages illustrés par D. M. Chodowiecki jusqu'en Angleterre, où ils devinrent très recherchés des collectionneurs. L’artiste resta dans les annales grâce à une œuvre en particulier, Le voyage de Berlin à Dantzig en l’an 1773 (Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773). Ce cycle composé de 108 gravures raconte son périple depuis la capitale de Prusse jusqu’à sa ville natale. D. M. Chodowiecki choisit le genre très populaire pendant la période des Lumières du récit de voyage. Or, il le présenta sous forme graphique. Les lecteurs n’apprécièrent son art à sa juste valeur qu’un siècle plus tard, avec la parution berlinoise d’une belle édition annotée du Voyage. Elle était enrichie par les descriptions extraites des mémoires de l’artiste, précédant chaque image d'une séquence narrative. Le récit commence par ses adieux à la famille, ensuite nous assistons à une conversation joyeuse avec un compagnon de voyage, ensuite nous le voyons traverser l'Oder sur une barque, se balader dans des ruelles des diverses villes et dans des auberges disséminées le long de la route. Le voyage de Berlin à Dantzig couvre une période de deux mois et constitue une source extraordinaire de savoir architectural ou ethnographique, sur les mœurs et vêtements de cette époque. Toute la famille de D. M. Chodowiecki était extraordinairement douée. Ses cousins et ses enfants choisirent, eux aussi, la peinture et la gravure. Parmi eux, se distingua particulièrement sa fille Susanne Henry (1764-1819). Ses cycles picturaux la firent surnommer « le Hogarth féminin ». Après sa nomination à la fonction de professeure à l’École des Beaux-Arts de Berlin, la première femme à avoir cet honneur, elle créa un extraordinaire cycle d'eaux-fortes en miniatures dépeignant les mœurs de la fin du 18e et du début du 19e siècles, ainsi que des séries d'histoires en images, dont Les Effets d’un mariage heureux et malheureux (1802). Très difficiles à trouver, elles constituent désormais une découverte de choix pour les collectionneurs.
Un autre membre important du panthéon des précurseurs de la bande dessinée fut Michał Płoński (1778-1812). Cet artiste extraordinaire décéda à l’âge de trente-quatre ans, sans avoir obtenu la reconnaissance, dans un hôpital psychiatrique. Il travaillait à Paris, pour le Cabinet impérial des Gravures, et à Amsterdam. Son œuvre la plus intéressante en ce qui nous concerne reste une incroyable planche d'une proto-bande dessinée titrée Le Porteur de corbeilles (Niosący koszyki). Son style fait écho aux meilleurs dessins de Rembrandt. Ce récit métaphorique aborde le thème de la condition humaine, du caractère éphémère de la vie et de la matière. Le protagoniste est un marchand de corbeilles, semblable aux assistants du bourreau entourant la guillotine durant la Terreur. La dimension symbolique de chaque image du Porteur de corbeilles soutient la comparaison avec les représentations médiévales de Danses macabres.
Les deux auteurs prescripteurs de la forme des récits en images sur le territoire polonais durant les années 1840 et 1850 furent Jan Lewicki (1795-1871) et Artur Bartels (1818-1885).
J. Lewicki eut son bref moment de gloire en 1830, quand il conçut et produisit une série de cartes postales contenant des poèmes amusants, présentant des personnages connus du monde varsovien dans des situations gênantes. Le cycle, nommé Les Balayettes satiriques (Miotełki satyryczne), jouissait d’une immense popularité parmi des habitants les plus pauvres de la ville, des ouvriers et des domestiques. Plus tard, à deux reprises, en 1850 et 1853, à Paris et sur le territoire polonais, parut son album de vingt-deux pages grandioses. C'était une adaptation des mémoires baroques de Jan Chryzostom Pasek. Le récit décrit les conflits, les mœurs et les voyages d’un noble polonais. Il est dessiné dans le style maniériste des planches du peintre et graveur italien Antonio Tempesta. L’élaboration de cette œuvre riche en détails dura presque dix ans. Elle ne garantit pas la renommée à J. Lewicki, mais lui assura une place en tant que cartographe à la cour du roi du Portugal. En 1858, également à Paris, Jan Kazimierz Wilczyński publia chez la maison d'édition Lemercier trois albums d’Artur Bartels, sur six manuscrits conservés à Vilnius. Ces images satiriques illustrent avant tout les changements de mœurs (culturelles et économiques) de la province polonaise, amenés par les nouvelles idées du scientisme et la révolution industrielle. Le conflit entre « l’ancien » et « le nouveau » y donne naissance à un communisme semblant sorti d’une pièce de Molière. Monsieur Atanazy Skorupa, homme progressiste (Pan Atanazy Skorupa, człowiek postępowy) et Monsieur Eugène (Pan Eugeniusz) furent dessinés suivant le style des bandes dessinées d'alors de la presse britannique. La première série, dans l’ordre chronologique, fut Le Grippe-sou (Łapigrosz), redessinée et améliorée par l’excellent poète et peintre polonais Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). Par sa forme, elle se rapproche des meilleures bandes dessinées de Rodolphe Töpffer. Aucun des deux créateurs, ni J. Lewicki, ni A. Bartels, ne provoqua une révolution artistique en Pologne, ni ne fut particulièrement connu de son vivant.
En revanche, furent décisives l’arrivée en 1859 de L’Hebdomadaire illustré (Tygodnik Illustrowany), vite suivie par celle d’autres périodiques, ainsi que l’activité de Franciszek Kostrzewski (1826-1911). Ce dernier est l'auteur de la première véritable bande dessinée de presse en Pologne, L’histoire d’un fils unique (Historya Jedynaczka, 1859). Dès lors, les récits en images polonais devinrent populaires jusqu'à s'intégrer au courant plus vaste de la culture générale.
Paweł Chmielewski
Les manuscrits enluminés médiévaux européens se distinguaient par leur picturalité. Ils étaient fortement inspirés, après la fin du 11e siècle, par les réalisations artistiques de l’Orient antique découvertes au début des croisades. Cette influence se retrouva surtout dans des cycles d’illustrations, y compris en Pologne. Des enluminures à vocation narrative ornent les pages des plus vieux codexes de l’art roman, parmi lesquels il convient de mentionner l’Évangéliaire de Plock (Ewangelistarz płocki), connu aussi d'après le nom de l’endroit de sa conservation, en tant que Codex de Pultusk(Kodeks pułtuski). Ce « manuel » pour prêtres et ses illustrations furent créés peu après 1075. Le Codex doré de Gniezno (Złoty kodeks gnieźnieński) est daté généralement de la même époque et la Bible de Czerwien (Biblia czerwieńska), produite durant le siècle suivant, fut perdue lors de l'Insurrection de Varsovie (1944). Le parchemin ne fut pas toujours le support sur lequel on immortalisa les récits narrés en images. La représentation la plus ancienne – parmi celles connues à ce jour en Pologne – dévoile huit scènes de la vie de Gédéon, personnage issu de l’Ancien testament, gravées au 10e siècle sur les parois de la « coupe de Wroclaw ». L’exemple le plus célèbre et le plus sophistiqué annonçant l’art séquentiel sont les deux pans moulés en bronze de la porte de la cathédrale de Gniezno, datant d'environ 1170. Ils illustrent en deux panneaux horizontaux de neuf « cadres » la vie et la mort de Saint Adalbert.
Durant la période que Johan Huizinga appela « L’Automne du Moyen Âge », à Cracovie, alors la capitale du royaume de Pologne, fonctionnaient des imprimeries dont les livres ornés de récits en images jouissaient d’un grand succès. Aujourd’hui nous pourrions les définir comme des précurseurs de la bande dessinée. Il convient d'en énumérer ici quelques-uns. La première de ces publications prenait pour modèle la forme connue des « Bibles des pauvres » néerlandaises et allemandes. Intitulée l'Évangéliaire d’Ungler (Ewangeliarz Unglera) et due à Jan de Sącz (alias Johannes Maletius, 1482-1567), elle fut imprimée vers 1527. En 1561, les héritiers de l’imprimeur cracovien le plus connu de l’époque, Marek Szarfenberg (vers 1490-1545), confectionnèrent la Bible dite du Léopolite (Biblia Leopolity). Ses 1266 pages contiennent pas moins de 296 gravures accompagnées de leurs descriptions. Dans ce volumineux ouvrage, qui constitue également l'un des monuments de la langue polonaise, le gros des illustrations se trouve dans l’Apocalypse de saint Jean. Cette partie mystérieuse et riche en symboles du Nouveau Testament fut ornée de vingt-six gravures sur bois. Celles-ci composent une œuvre graphique et narrative uniforme. Elles se caractérisent par un grand dynamisme, représentant des personnages fantastiques et dotés de caractéristiques distinctes, ainsi que des phénomènes surnaturels, avec des revirements soudains et une trame cohérente grâce à un écoulement du temps marqué. Ces gravures sont accompagnées par de courts textes dépeignant le contenu des images. Et complétons leur analyse par deux caractéristiques relevant du domaine de la théorie de la bande dessinée – elles constituent une œuvre populaire et largement accessible. Les derniers représentants des formes cracoviennes de récits en images de l’époque de la fin du Moyen Âge et du début de la Renaissance sont Le Codex de Balthasar Behem (Kodeks Baltazara Behemade, 1505), par un artiste anonyme imitant le style pictural de Jérôme Bosch, ainsi que les calendriers illustrés et les recueils de prémonitions créés par l’astronome et professeur Michał de Wiślica (vers 1499-1575), de l’Académie de Cracovie. Citons encore, issue de la littérature « vulgaire », l’œuvre satirique de Jan de Koszyczki (vers 1488-1546), Les conversations du sage Roy Salomon avec Marcholt gros et obscène (Rozmowy które myał Król Salomon mądry z Marchołtem grubym a sprosnym, 1521). Elle contient une série d’illustrations d’un graveur anonyme.
Parmi d'autres graveurs et les imprimeurs de l’époque qui choisirent l’émigration, on trouve Jan Ziarnko (1575-1626). Le nom de ce peintre originaire de Lviv figure parmi les six illustrateurs des cycles contenus dans le livre français richement illustré Les peintures sacrées sur la Bible (1665), dont le jésuite Antoine Girard fut l’éditeur et l’auteur de la préface. J. Ziarnko décéda avant sa publication, mais les notes contenues dans les commentaires de l'ouvrage prouvent qu’il jouissait d’une certaine renommée en France.
Parmi les créations qui pavèrent le chemin de la bande dessinée de presse, il convient de se pencher sur les journaux de mode du 17e siècle. C’est dans ce cadre et au moyen d'un style esthétique baroque proche de celui des précurseurs de la bande dessinée allemande et française qu'un habitant de Dantzig, Anton Möller (vers 1563-1611), créa Les habits de tous les états… (Wszystkich stanów ubrania...,1601). Ses vingt gravures annotées présentaient des modèles, de manière remarquable, de différents points de vue, de profil, de semi-profil, de dos, anticipant véritablement le travail d'un photographe. Elles présentaient un profil social complet des personnages de Dantzig, des domestiques et citadines pauvres jusqu’aux femmes de banquiers et de riches patriciennes.
Dantzig fut aussi la ville natale de Daniel Mikołaj Chodowiecki(1726-1801). Ce fils d’un polonais et d’une huguenote suisse devint l'illustrateur des livres les plus convoités sur le marché allemand. Ses gravures pour La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, les œuvres de Gotthold Ephraim Lessing et des romans populaires pérennisèrent sa notoriété. Durant les guerres napoléoniennes, les soldats britanniques ramenèrent les ouvrages illustrés par D. M. Chodowiecki jusqu'en Angleterre, où ils devinrent très recherchés des collectionneurs. L’artiste resta dans les annales grâce à une œuvre en particulier, Le voyage de Berlin à Dantzig en l’an 1773 (Podróż z Berlina do Gdańska w roku 1773). Ce cycle composé de 108 gravures raconte son périple depuis la capitale de Prusse jusqu’à sa ville natale. D. M. Chodowiecki choisit le genre très populaire pendant la période des Lumières du récit de voyage. Or, il le présenta sous forme graphique. Les lecteurs n’apprécièrent son art à sa juste valeur qu’un siècle plus tard, avec la parution berlinoise d’une belle édition annotée du Voyage. Elle était enrichie par les descriptions extraites des mémoires de l’artiste, précédant chaque image d'une séquence narrative. Le récit commence par ses adieux à la famille, ensuite nous assistons à une conversation joyeuse avec un compagnon de voyage, ensuite nous le voyons traverser l'Oder sur une barque, se balader dans des ruelles des diverses villes et dans des auberges disséminées le long de la route. Le voyage de Berlin à Dantzig couvre une période de deux mois et constitue une source extraordinaire de savoir architectural ou ethnographique, sur les mœurs et vêtements de cette époque. Toute la famille de D. M. Chodowiecki était extraordinairement douée. Ses cousins et ses enfants choisirent, eux aussi, la peinture et la gravure. Parmi eux, se distingua particulièrement sa fille Susanne Henry (1764-1819). Ses cycles picturaux la firent surnommer « le Hogarth féminin ». Après sa nomination à la fonction de professeure à l’École des Beaux-Arts de Berlin, la première femme à avoir cet honneur, elle créa un extraordinaire cycle d'eaux-fortes en miniatures dépeignant les mœurs de la fin du 18e et du début du 19e siècles, ainsi que des séries d'histoires en images, dont Les Effets d’un mariage heureux et malheureux (1802). Très difficiles à trouver, elles constituent désormais une découverte de choix pour les collectionneurs.
Un autre membre important du panthéon des précurseurs de la bande dessinée fut Michał Płoński (1778-1812). Cet artiste extraordinaire décéda à l’âge de trente-quatre ans, sans avoir obtenu la reconnaissance, dans un hôpital psychiatrique. Il travaillait à Paris, pour le Cabinet impérial des Gravures, et à Amsterdam. Son œuvre la plus intéressante en ce qui nous concerne reste une incroyable planche d'une proto-bande dessinée titrée Le Porteur de corbeilles (Niosący koszyki). Son style fait écho aux meilleurs dessins de Rembrandt. Ce récit métaphorique aborde le thème de la condition humaine, du caractère éphémère de la vie et de la matière. Le protagoniste est un marchand de corbeilles, semblable aux assistants du bourreau entourant la guillotine durant la Terreur. La dimension symbolique de chaque image du Porteur de corbeilles soutient la comparaison avec les représentations médiévales de Danses macabres.
Les deux auteurs prescripteurs de la forme des récits en images sur le territoire polonais durant les années 1840 et 1850 furent Jan Lewicki (1795-1871) et Artur Bartels (1818-1885).
J. Lewicki eut son bref moment de gloire en 1830, quand il conçut et produisit une série de cartes postales contenant des poèmes amusants, présentant des personnages connus du monde varsovien dans des situations gênantes. Le cycle, nommé Les Balayettes satiriques (Miotełki satyryczne), jouissait d’une immense popularité parmi des habitants les plus pauvres de la ville, des ouvriers et des domestiques. Plus tard, à deux reprises, en 1850 et 1853, à Paris et sur le territoire polonais, parut son album de vingt-deux pages grandioses. C'était une adaptation des mémoires baroques de Jan Chryzostom Pasek. Le récit décrit les conflits, les mœurs et les voyages d’un noble polonais. Il est dessiné dans le style maniériste des planches du peintre et graveur italien Antonio Tempesta. L’élaboration de cette œuvre riche en détails dura presque dix ans. Elle ne garantit pas la renommée à J. Lewicki, mais lui assura une place en tant que cartographe à la cour du roi du Portugal. En 1858, également à Paris, Jan Kazimierz Wilczyński publia chez la maison d'édition Lemercier trois albums d’Artur Bartels, sur six manuscrits conservés à Vilnius. Ces images satiriques illustrent avant tout les changements de mœurs (culturelles et économiques) de la province polonaise, amenés par les nouvelles idées du scientisme et la révolution industrielle. Le conflit entre « l’ancien » et « le nouveau » y donne naissance à un communisme semblant sorti d’une pièce de Molière. Monsieur Atanazy Skorupa, homme progressiste (Pan Atanazy Skorupa, człowiek postępowy) et Monsieur Eugène (Pan Eugeniusz) furent dessinés suivant le style des bandes dessinées d'alors de la presse britannique. La première série, dans l’ordre chronologique, fut Le Grippe-sou (Łapigrosz), redessinée et améliorée par l’excellent poète et peintre polonais Cyprian Kamil Norwid (1821-1883). Par sa forme, elle se rapproche des meilleures bandes dessinées de Rodolphe Töpffer. Aucun des deux créateurs, ni J. Lewicki, ni A. Bartels, ne provoqua une révolution artistique en Pologne, ni ne fut particulièrement connu de son vivant.
En revanche, furent décisives l’arrivée en 1859 de L’Hebdomadaire illustré (Tygodnik Illustrowany), vite suivie par celle d’autres périodiques, ainsi que l’activité de Franciszek Kostrzewski (1826-1911). Ce dernier est l'auteur de la première véritable bande dessinée de presse en Pologne, L’histoire d’un fils unique (Historya Jedynaczka, 1859). Dès lors, les récits en images polonais devinrent populaires jusqu'à s'intégrer au courant plus vaste de la culture générale.


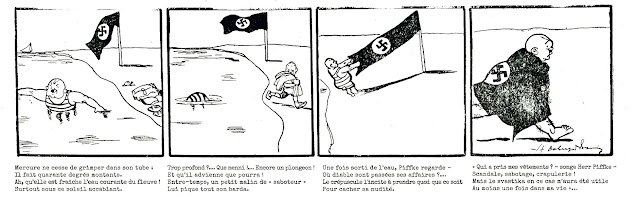

Komentarze
Prześlij komentarz